L’Étude phare
Cette étude utilise la modélisation des données pour prévoir l'avenir des troubles neurocognitifs au Canada. Les données de l'étude sont analysées dans trois rapports. Le premier rapport, datant de 2022, examinait les chiffres nationales. Le deuxième rapport, publié en 2024, examine les troubles neurocognitifs dans les groupes démographiques. Le troisième rapport, en 2025, examinera les impacts économiques.

L'étude phare de la Société Alzheimer du Canada utilise une modélisation de données approfondie et fondée sur des données probantes pour prévoir l'avenir de les troubles neurocognitifs.
Les données de l'étude sont présentées dans trois rapports.
- Le premier rapport, publié en septembre 2022, examine la niveau national des troubles neurocognitifs jusqu’en 2050.
- Le deuxième rapport, publié en janvier 2024, examine les projections en matière des troubles neurocognitifs dans différents groupes démographiques.
- Le troisième rapport, qui sera publié en 2025, examinera les impacts économiques des troubles neurocognitifs dans les années à venir.
Étude phare, rapport 2 : Les multiples facettes des troubles neurocognitifs au Canada

Les troubles neurocognitifs sont un problème majeur de santé publique au Canada et dans le monde entier, touchant des centaines de milliers de personnes au niveau national et des millions à l'international. Les recherches montrent de grandes différences dans les risques, les taux, les symptômes et les résultats des troubles neurocognitifs à travers les communautés au Canada, y compris des différences liées à l'origine autochtone, à l'ethnicité, à la race, au sexe, au genre, à l'âge et plus encore.
Avec la hausse rapide de notre population vieillissante au Canada, ceci est l'une des premières études qui cherche à mieux comprendre les nombreuses facettes des troubles neurocognitifs et à trouver des solutions équitables aux difficultés qui y seront associées, afin que personne ne soit laissé de côté.
Comprendre les besoins et les expériences uniques de toutes les communautés est une étape clé pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un trouble neurocognitif et de leurs proches aidants.
Lisez le rapport à alzheimer.ca/etude-phare-2.
Étude marquante, rapport 1 : Les troubles neurocognitifs au Canada: Quelle direction à l'avenir?
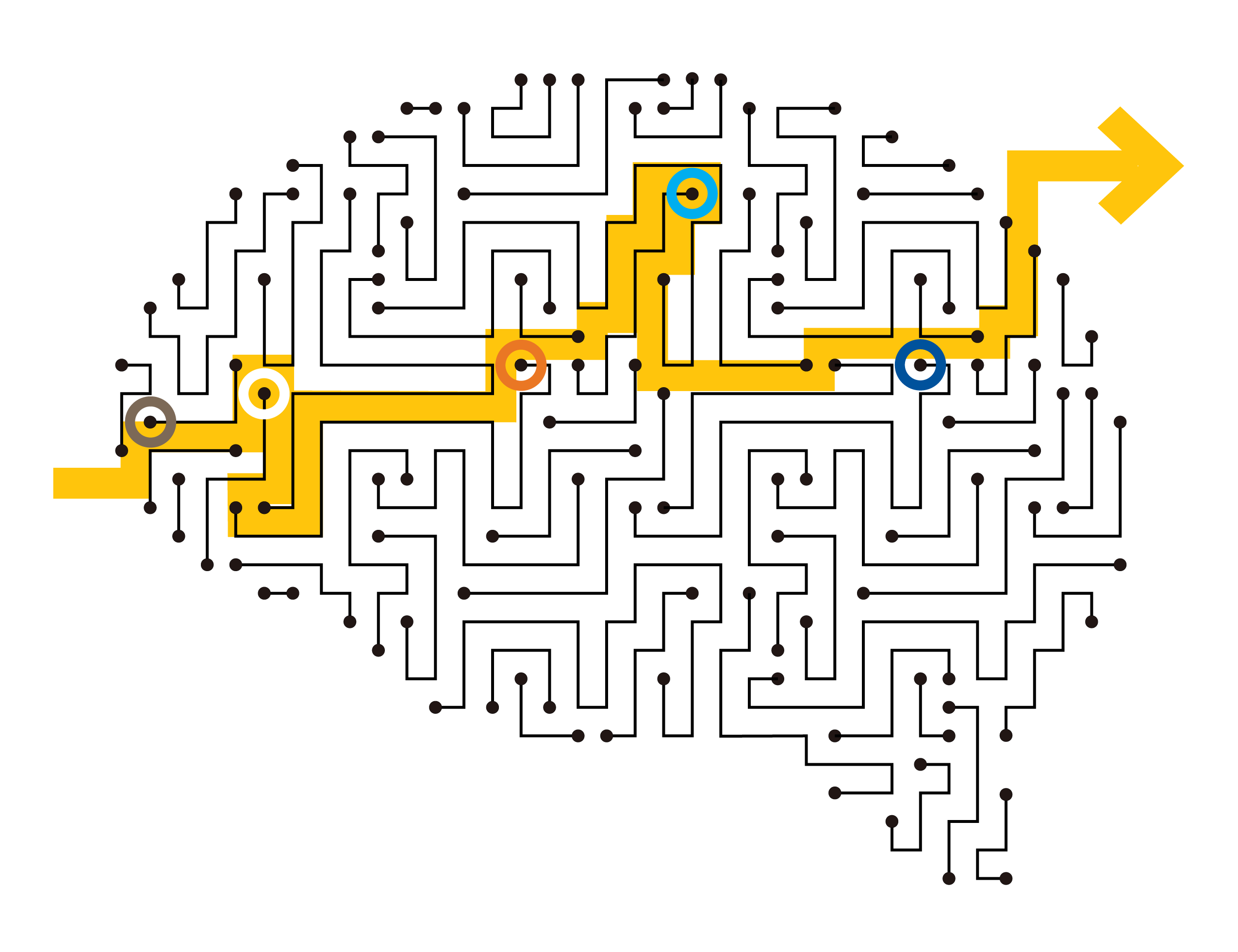
Publié le 6 septembre 2022, Les troubles neurocognitifs au Canada: Quelle direction à l'avenir? présente les chiffres clés et les prochaines étapes concernant les troubles neurocognitifs au Canada.
La minimisation du risque ou le ralentissement de l’apparition des troubles neurocognitifs sont des nouvelles porteuses d’espoir. Cependant, le vieillissement de la population au Canada signifie que nous continuerons d’observer une augmentation constante du nombre de personnes touchées.
Bien que les progrès enregistrés au cours de la dernière décennie nous permettent de mieux aborder ces maladies du cerveau, il reste encore beaucoup à faire.
Pour lire le rapport, visitez alzheimer.ca/etude-marquante.
Téléchargez le PDF du premier rapport de l’Étude marquante : Les troubles neurocognitifs au Canada : quelle direction à l’avenir?

